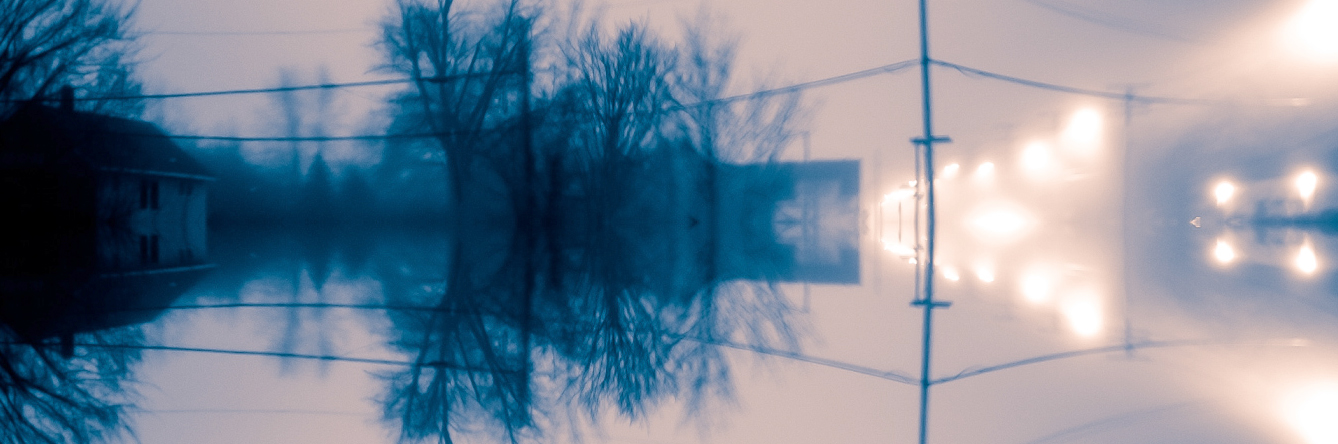V.F.
Il est tout à fait légitime – et même courant – de parler de « degrés » de fictionnalité. Ne dit-on pas que Le Seigneur des anneaux est plus fictionnel que Le Père Goriot, ou qu’A la recherche du temps perdu l’est moins que le roman de Balzac ? Or, ces usages qui relèvent du langage ordinaire deviennent problématiques dès qu’on tente de définir la nature de la fiction : qu’il s’agisse d’une approche sémantique (fiction comme discours non-référentiel) ou pragmatique (fiction comme feintise partagée), les théoriciens de la fiction adoptent souvent une définition binaire, opposant la fictionnalité à la non-fictionnalité (ou à la factualité). L’hybridité de la fiction a en effet suscité de nombreuses controverses, comme en témoignent les débats autour du statut générique de l’autofiction ou encore de la valeur référentielle des noms propres dans l’œuvre de fiction. C’est pour explorer ces questions épineuses dans une perspective transculturelle et transdisciplinaire que nous avons choisi de consacrer le troisième congrès international de notre société aux « degrés de fictionnalité ».
Ce colloque s’est tenu à l’Université Kwansei Gakuin (Hyogo, Japon) les 18, 19 et 20 octobre 2024, en présentiel et en ligne. Il a rassemblé 77 chercheurs provenant de plus de 15 pays, dont une cinquantaine se sont déplacés pour se rendre sur les deux campus de l’université situés à Osaka et à Nishinomya. Les participants ont pu consulter, en amont, les documents issus des journées d’études organisées par Alison James, Françoise Lavocat et moi-même dans le Centre parisien de l’Université de Chicago, en juin de la même année, et dont l’objectif était de préciser et d’approfondir les enjeux théoriques de cette question.
Les communications présentées lors de notre colloque ont illustré une grande diversité culturelle et disciplinaire. Elles ont permis de comparer les spécificités narratives des romans autobiographiques ou des autofictions, mais aussi de la SF ou de la fantasy à travers le monde. Nous avons également pu réfléchir au statut du réalisme dans différentes aires culturelles ou nous demander dans quelle mesure les degrés de fictionnalité sont historiques. Si une grande partie des communications portait sur la littérature, d’autres médias ont également été examinés : films, bandes dessinées, jeux vidéo ou encore vidéos sur Youtube. Ces interventions ont exploré non seulement l’hybridité propre à ces supports, mais aussi la transmédialité de la fiction. Les communications consacrées aux questions théoriques se sont révélées aussi nombreuses qu’enrichissantes. Les concepts narratologiques ont été revisités (la métalepse a constitué une session à elle seule). L’approche rhétorique de la fictionnalité, distinguant fiction globale et fiction partielle, a suscité plusieurs débats. Il va sans dire que les réflexions philosophiques ont occupé une place importante dans notre colloque. Contentons nous de signaler que plusieurs communications, s’appuyant sur la philosophie analytique ou sur les sciences cognitives, ont examiné l’hybridité des œuvres fictionnelles sous l’angle des mécanismes et des fonctions de l’imagination ou de la croyance.
Le congrès s’est déroulé en trois sessions parallèles, ce qui a malheureusement empêché les participants d’assister à toutes les communications (cette frustration a partiellement été atténuée grâce aux enregistrements, désormais accessibles aux membres de la société). Nous avons eu aussi le plaisir de nous réunir pour écouter deux conférences plénières. Selon la proposition d’Anne Duprat, la temporalité fictionnelle se caractérise par sa « structure graduelle », qu’elle a explorée dans ses différents états. Cette temporalité qui agit à la fois comme métaphore et modèle du temps réel suggère une ontologie « mobiliste », c’est-à-dire fondée sur les événements. Jean-Marie Schaeffer, quant à lui, est revenu sur les trois définitions classiques de la fiction – sémantique, syntaxique et pragmatique. Il a conclu que seule une définition « faible », issue de l’approche pragmatique impliquant en réalité une exclusion forte de la définition sémantique, permettrait d’apprécier pleinement l’hybridité et les degrés de fictionnalité. Il a également souligné que, du point de vue anthropologique, la fiction est vécue dans une zone psychique où imagination et réalité s’entremêlent. Ajoutons que cette dernière conférence, suivie par un entretien avec Yasusuke Oura, a aussi été l’occasion pour rendre hommage aux deux chercheurs pour leurs contributions majeures à l’étude de la fiction.
A l’hommage s’ajoute un encouragement : depuis le colloque de Chicago, la société décerne un prix destiné à soutenir les chercheuses et chercheurs en début de carrière. Celui de cette année a été décerné à Jeppe Barnwell pour son article stimulant intitulé « Fictionality, Fictionhood, and Fiction – Towards a New Typology of Fictional Invention ». Compte tenu de la grande qualité des autres contributions soumises, le comité a par ailleurs décidé d’honorer Emilio Gianotti, pour « World Hoarding : Hypermodernity and Multiverse Fictions », et Yang Liu, pour « The Spectres of Realism ». La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans une ambiance amicale, à l’occasion du cocktail organisé après une journée riche en réflexions et en échanges.
Ainsi, ce colloque s’achève avec succès. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, mes co-organisatrices, Françoise Lavocat et Alison James, le comité de la SIRFF/ASIFF, ainsi que mes amis et mes étudiantes qui ont apporté leur aide précieuse. Comme l’a fait remarquer Françoise Lavocat dans son dernier éditorial, ce colloque marque la fin du cycle lié à la fondation de la société. Le prochain colloque, prévu en 2026, inaugurera une nouvelle étape pour la SIRFF/ASIFF, mais le plaisir de nous retrouver et d’échanger restera inchangé.
English Version
It is entirely legitimate and even common to speak of “degrees” of fictionality. For example, we might say that The Lord of the Rings is more fictional than Old Goriot, or In Search of Lost Time is less fictional than Balzac’s novel. These locutions, rooted in ordinary language, nevertheless become problematic when we attempt to define the nature of fiction. Theorists of fiction, whether adopting a semantical approach (fiction as non-referential discourse) or a pragmatic approach (fiction as shared pretense), commonly employ a binary definition that contrasts fictionality with non-fictionality (or factuality). The hybridity of fiction has sparked numerous controversies, as evidenced by debates surrounding the generic status of autofiction or the referential value of real proper names in fictional works. To explore these complex and challenging questions from a transcultural and transdisciplinary perspective, we chose “Degrees of Fictionality” as the topic of the third international congress of our association.
This congress took place at Kwansei Gakuin University (Hyogo, Japan) on October 18th, 19th and 20th, 2024, in both in-person and online formats. 77 researchers from more than 15 countries participated in the conference, with many traveling to come to the university’s two campuses, located in Osaka and Nishinomiya. Prior to the conference, participants had access to the documents from a workshop organized by Alison James, Françoise Lavocat and myself at the University of Chicago Center in Paris in June 2024. This workshop aimed to clarify and deepen the understanding of the theoretical stakes of the subject.
The papers presented at our conference exhibited remarkable cultural and disciplinary diversity. They invited us to compare the narrative characteristics of autobiographical novels or autofiction, as well as science fiction and fantasy, across the world. Discussions also addressed the status of realism in various cultural contexts or the historicity of fictionality and its degrees. While many presentations focused on literature, other media – such as movies, comics, videogames or even YouTube videos – were also examined. These contributions explored not only the hybridity peculiar to these media but also the transmediality of fiction. Theoretical debates were equally dynamic. Narratological concepts were revisited from fresh perspectives (with metalepsis receiving its own dedicated session). The rhetorical approach to fictionality, distinguishing global fiction from local fiction, gave rise to significant discussions. It goes without saying that philosophical issues also played a key role. Notably, several papers drew on analytical philosophy or cognitive sciences to examine the hybridity of fictional works in relation to the mechanisms and functions of imagination or belief.
The congress was organized into three parallel sessions, which unfortunately made it impossible for participants to attend every presentation (this frustration has been partially alleviated by the recorded materials now available to members of the association). Nonetheless, two keynote addresses provided occasions for everyone to gather. Anne Duprat proposed that fictional temporality is characterized by its “gradual structure,” which she explored in its various states. Through this temporality, which operates as both a metaphor and a model for real time, she proposed a “mobilist” ontology – that is, one founded on events. Jean-Marie Schaeffer revisited the three classical definitions of fiction – semantic, syntactical and pragmatic. He concluded that only a “weak” definition, rooted in the pragmatic approach – which, in fact, strongly excludes the semantic perspective – fully captures the hybridity or degrees of fictionality. Schaeffer also emphasized that, from an anthropological perspective, the experiences of fiction occur in a psychological area where imagination and reality intertwine. This final keynote, followed by a discussion with Yasusuke Oura, was also an opportunity to pay tribute to these two scholars who have significantly advanced the study of fiction.
In addition to this tribute, we also encouraged emerging scholars. Since the congress in Chicago, the ASIFF/SIRFF has awarded a prize to support early-career researchers. This year, the prize was awarded to Jeppe Barnwell for his insightful paper “Fictionality, Fictionhood, and Fiction – Towards a New Typology of Fictional Invention”. Given the excellent quality of other submitted papers, the committee also decided to give honorable mentions to Emilio Gianotti, for “World Hoarding: Hypermodernity and Multiverse Fictions” and Yang Liu, for “The Spectres of Realism”. The Prize ceremony took place in a warm and friendly atmosphere during the cocktail reception following a fruitful day of discussions.
The congress thus concluded successfully. I warmly thank all the participants, the ASIFF/SIRFF board, my co-organizers, Françoise Lavocat and Alison James, as well as my friends and students for their invaluable assistance. As Françoise Lavocat noted in her editorial, this congress marks the end of the cycle associated with the founding of the association. A new chapter for the association will begin with the next congress in 2026. However, the pleasure of meeting and engaging in meaningful discussions will remain the same.